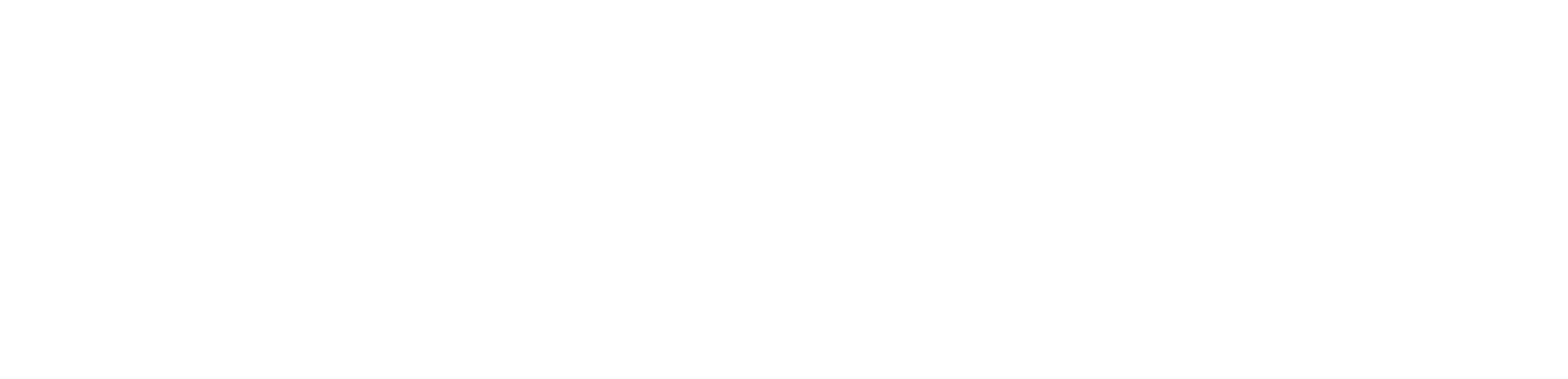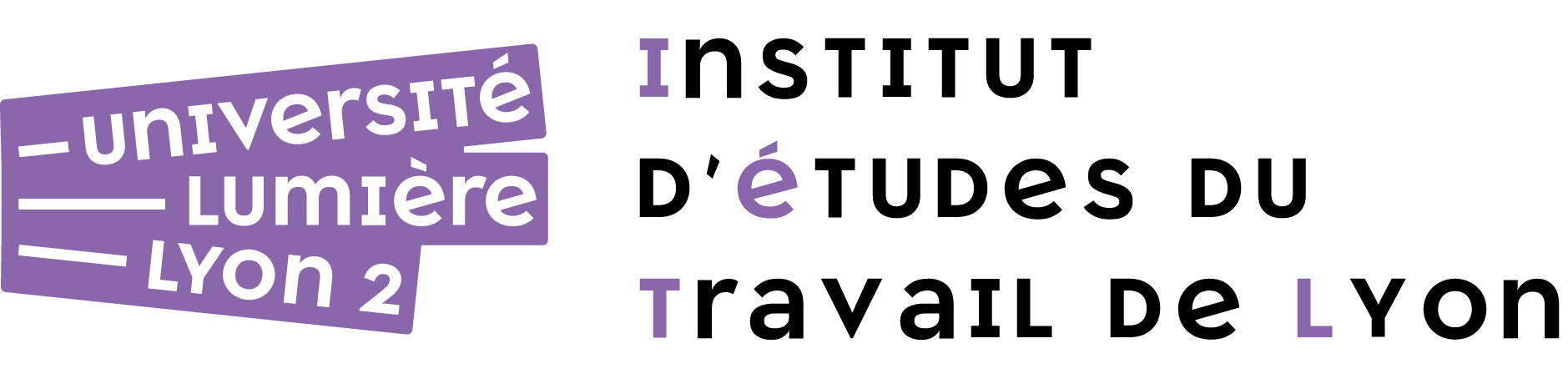Dans le cadre de ses Après-midi de la protection sociale, l’Institut d’Études du Travail de Lyon propose des rendez-vous réguliers, en mode hybride, autour de thèmes d’actualité ou de questions plus générales qui interrogent notre société.
- Année 25/26
-
- Première session : Le contrôle de la recherche d'emploi : normes, agents, contentieux.
Mardi 9 décembre 2025 de 14h à 16h, en mode hybride. -
→ Lien pour suivre la séance en direct sur Teams
Le contrôle de la recherche d’emploi est devenu depuis une dizaine d’années une composante importante de la lutte contre le chômage, une évolution qui s’accélère en raison des orientations données lors du passage de Pôle Emploi à France Travail. Bien que la procédure de contrôle ait des conséquences cruciales pour des centaines de milliers de demandeur·ses d’emploi, elle demeure à ce jour très peu étudiée.
Partant de ce constat, un programme de recherche, soutenu par l’Institut Robert Badinter, prend pour objet le contrôle de la recherche d’emploi dans ses différentes dimensions politiques, administratives, règlementaires et judiciaires, à l’appui d’une méthodologie pluridisciplinaire combinant sociologie, science politique et droit.Les résultats de ce programme, publiés ici, seront présentés lors de cette séance des Après-midi de la protection sociale par les membres de l'équipe de recherche : Claire Vivès, ingénieure de recherche en sociologie au CNAM (LISE-CEET), Claire Magord, maîtresse de conférences en droit privé à l’Université de Poitiers (CECOJI), Tristan Pellerin, doctorant contractuel à l’Université de Rennes (IODE), Jean-Marie Pillon, maître de conférences en sociologie à l’Université de Saint-Étienne (Centre Max Weber), Luc Sigalo Santos, maître de conférences en science politique à Aix-Marseille Université (LEST) et Laure Camaji, maîtresse de conférences HDR à l’IETL, Université Lumière Lyon 2 (CERCRID).
Cette présentation sera suivie d’échanges au cours desquels interviendront Hugo Avvenire, maître de conférences en droit public à l’Université de Poitiers (IDP) et Jérôme Pélisse, professeur des universités, directeur des études doctorales en sociologie à Sciences Po (CSO).
- Première session : Le contrôle de la recherche d'emploi : normes, agents, contentieux.
- Année 24/25
-
- Première session : Travail en prison.
Jeudi 17 octobre 2024 de 14h à 16h, en mode hybride. -
→ Lien pour (re)voir la séance sur YouTube
Fruit d’un important travail interministériel, la réforme du travail pénitentiaire, issue de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021, a entendu rapprocher les conditions d’emploi des personnes détenues du droit commun de celle des salariés, en instaurant un nouveau contrat d’emploi pénitentiaire (CEP). Plus largement, l’ambition est, selon les termes du Ministère de la Justice, de « faire évoluer la philosophie de la relation de travail des personnes détenues avec les établissements pénitentiaires et les entreprises ». Depuis son entrée en vigueur le 1er mai 2022, quel état des lieux dresser ? S’agit-il d’avancées décisives pour ces travailleurs, principalement affectés à des tâches répétitives et non-qualifiantes, longtemps privés de contrat et donc de protection du droit du travail ? En réorganisant l’activité productive en prison, quelle politique du travail pénitentiaire la loi met-elle en place ?
Il sera aussi question de l’ordonnance du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, qui améliore de manière notable la protection sociale des détenus travailleurs, mais dont les décrets ne sont pas encore parus. En fil conducteur de ces débats, une question majeure sera posée : se dirige-t-on (enfin) vers la normalisation des droits sociaux des travailleurs en prison ?Avec les interventions de Philippe Auvergnon (Directeur de recherche au CNRS, Université de Bordeaux), Lola Isidro (Maîtresse de conférences à l’Université Paris-Nanterre), Prune Missoffe (Responsable analyses et plaidoyer, Observatoire international des prisons – section française). Références bibliographiques :
P. Auvergnon, « Travail en prison : retour sur une réforme toujours en cours », Semaine Sociale Lamy 2024, n° 2099, p. 5.
P. Auvergnon, « Quand la lutte contre la récidive permet et limite les progrès de l'encadrement juridique du travail en prison », Dr. soc. 2022, p.352.
P. Auvergnon, « Droit du travail en prison : goutte à goutte l’eau creuse la roche », in J. Schmitz et M.-C. Amauger-Lattes (dir.), Quelle normalisation de la relation de travail en prison ? Enjeux et perspectives d’une réforme, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2022.
P. Auvergnon, M. Crétenot, N. Ferran, C. Wolmark, « Propositions pour un statut juridique du détenu travailleur », Droit social 2019, p.1075.L. Isidro, « Penser les droits collectifs des travailleurs en prison », in J. Schmitz et M.-C. Amauger-Lattes (dir.), Quelle normalisation de la relation de travail en prison ? Enjeux et perspectives d’une réforme, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2022.
L. Isidro, T. Pasquier, « Projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire » : une ébauche de statut pour les détenus travailleurs », Lexbase, La lettre juridique n°868, 10 juin 2021.
L. Isidro, « L’incapacité du régime actuel du travail en détention à préparer la réinsertion », in J. Schmitz (dir.), Le droit à la réinsertion des personnes détenues, Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques et Essais, 2017.
L. Isidro, « Le travail en prison à l’aune des exigences fondamentales de l’OIT », in Ph. Auvergnon (dir.), Droit du travail en prison : d’un déni à une reconnaissance ?, Presses universitaires de Bordeaux, 2015.OIP, Une main d’œuvre « d’appoint », sous-payée et muselée : le 1er mai s’arrête aux portes de la prison, 28 avril 2023.
OIP, Le Conseil de l’Europe épingle la France sur la rémunération indécente des travailleurs détenus, 5 avril 2023.
OIP, Travail en prison : droits au rabais pour une flexibilité maximale, 1er juillet 2022.
OIP, Travail en prison : une réforme indispensable mais inaboutie, 28 septembre 2021. - Deuxième session : Sportif salarié : un droit social spécial ?
Mardi 3 décembre 2024 de 14h à 16h, en mode hybride. -
→ Lien pour (re)voir la séance sur YouTube
Sur site, la séance aura lieu amphi Fugier.
Les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 avec leur cortège de « bénévoles », les accusations de viols aggravés à l’encontre de rugbymans français internationaux, l’adoption en réaction d’une charte qui autorise la fédération française à sanctionner certains comportements, et, enfin, la récente décision de la CJUE en matière de transferts de footballeurs professionnels (CJUE, 4 oct. 2024, aff. C-650/22, FIFA) illustrent à quel point le sport professionnel est aujourd’hui au cœur du droit et de l’actualité. Ainsi, sous l’angle du droit social, les sportifs professionnels, et les arbitres qui assurent le bon déroulement des compétitions, sont soumis à un entrelac de dispositions nationales, qui relèvent tant du code du travail que du code du sport, européennes et internationales, mais également aux règlements des fédérations ou des ligues professionnelles qui en France exécutent une mission de service public.
S’est ainsi progressivement construit un « droit spécial » au niveau du droit du travail et du droit de la sécurité sociale qui fait des sportifs professionnels des salariés bien différents des autres, comme l’attestent les nombreuses singularités qui touchent leur protection sociale (par exemple pour des blessures corporelles par accident infligées aux footballeurs lors d’un match international), leur contrat de travail, son contenu, et les obligations dont ils sont débiteurs, particulièrement lorsqu’elles touchent à leur capital athlétique et mental. Nos trois intervenants échangeront sur ces différents points et expliqueront en quoi les différentes règles qui s’appliquent aux sportifs professionnels relèvent d’un « droit spécial », tant sur le plan du droit du travail que du droit de la sécurité sociale.Avec les interventions de Xavier Aumeran (Professeur, université Jean Moulin Lyon 3), David Jacotot (Professeur, université de Bourgogne) et François Mandin (Professeur, Nantes université). Références bibliographiques :
Xavier Aumeran, Maternité et parentalité : de nouvelles mesures pour les joueuses et entraîneures, Jurisport : La revue juridique et économique du sport, 2024, n°254, p. 6.
Xavier Aumeran, Aptitude médicale et recrutement des sportifs : des conditions suspensives sous surveillance, Jurisport : La revue juridique et économique du sport, 2024, n°252, p. 34.
Xavier Aumeran, Rupture du contrat de travail sans juste cause et conformité des sanctions au Traité, Jurisport : La revue juridique et économique du sport, 2022, n°236, p. 8.
Xavier Aumeran (dir.), Les transferts des sportifs dans un monde globalisé, Lexis Nexis, 2021, Perspective(s), 300 p.
Xavier Aumeran, La protection sociale du sportif salarié, LGDJ, Lextenso éditions, 2017, Bibliothèque de droit social, 491 p.David Jacotot, Les aspects du temps et de la durée du travail à l'épreuve de la XXIIIe Olympiade, Revue de droit du travail, 2024, n°06, p. 405 ;
David Jacotot, Un droit spécial du contrat de travail des sportifs, Semaine sociale Lamy, 15 juillet 2024, n° 2101, p. 7 ;
David Jacotot, La fin du contrat de travail à durée déterminée dit d'usage dans le sport professionnel, Droit Social, 2023, n°01, p. 50
David Jacotot, Cécile Chaussard, Cadre juridique d'attribution de l'olympiade Paris 2024 : un complexe normatif original, in Eric Monnin, Béatrice Lapérou-Scheneider, Laurent Kondratuk (dir.), L'Olympisme - Genèse, principes et gouvernance, Editions Désiris, 2023 ;
David Jacotot, (Re)penser le sort des « clauses de rupture » du contrat de travail à durée déterminée dans le sport , in Gaylor Rabu (dir.), Pour une réforme du code du sport, PU Aix-Marseille, 2023, pp. 103-121 ;
David Jacotot, Cécile Chaussard, Charles Fortier, (dir.), Le sport au carrefour des droits - Mélanges en l'honneur de Gérald Simon: mélanges en l'honneur de Gérald Simon, LexisNexis et CREDIMI, 2021, Travaux du Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, 579 p.François Mandin, Frédérique Roux, La fabrique de la loi en matière sportive, Jurisport : La revue juridique et économique du sport, 2023, n°246, p. 37 ;
François Mandin, « Focus - L'offre de loisirs sportifs et touristiques : quelques jalons juridiques », Juristourisme : le mensuel des acteurs du tourisme & des loisirs , 2014, n°163, p. 30 ;
François Mandin, Loïc Lerouge, Travail et protection sociale au bénéfice du sportif : Étude comparée : France, Italie, Royaume-Uni, Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2010, pp. 93-113 ;
François Mandin, Gilles Raveneau, Quand la pratique sportive croise le droit, Ethnologie française, 2006, n°4, pp. 669-676.
François Mandin, La libre circulation des sportifs en formation professionnelle, JCP S, n° 44, 2008, 1560, p. 11-15
François Mandin, Les sources du droit du sport in « Les sources du droit dans les pays européens et francophones » (Ss. Dir. Dariusz Piatek Piotr Szwedo (Auteur) Jacques Leroy (Auteur), Troisièmes journées juridiques franco-polonaises, Mare & Martin 2017, p. 305-320
François Mandin, Garanties de fond et procédure disciplinaire conventionnelle : nouvelle application dans le sport professionnel, Revue de Droit du travail, nº. 12, Déc. 2012, p. 694-695
François Mandin, Sport et CDD : entre ordre public social et ordre « public » sportif, JCP. S, 2012. 1404, p. 17-20. - Troisième session : Circulaires, il n’y a rien à voir !
Mardi 11 mars 2025 de 14h à 16h, en mode hybride. -
→ Lien pour (re)voir la séance sur YouTube
L’importance des circulaires et instructions ministérielles dans le droit de la protection sociale, et singulièrement dans le droit de la sécurité sociale, n’est pas discutable. Ces sources sont anciennes, nombreuses et assez bien connues, notamment parce qu’elles sont largement diffusées par les organismes concernés par leur mise en œuvre. Parfois désignés comme « petites sources du droit », « droit souterrain », « infra-droit », les instruments de la diffusion de cette doctrine administrative – les instructions, les circulaires, les notes et réponses ministérielles – connaissent un essor remarquable du fait de la consécration par la loi de leur opposabilité.
À ces instruments classiques s’ajoutent depuis plus d’une vingtaine d’années les chartes, dont la plus connue est la « charte du cotisant contrôlé », qui est dotée par la loi d’une incontestable force obligatoire, ou la « charte des accidents du travail et des maladies professionnelles », dont la dernière actualisation semble remonter à 2008, ainsi que d’autres objets juridiques inclassables, telles que les questions/réponses, les FAQ, ainsi que les positions des organismes diffusées par le truchement de leurs sites internet ou de sites qui, sans être officiels, ont reçu l’onction des organismes. Le tableau ne serait pas complet si l’on n’évoquait pas les procédures de rescrit, organisées ou non par des dispositions spéciales, qui produisent également des effets de droit.
Interprétant la loi, au risque parfois de la contredire et d’être frappées d’illégalité, non créateurs de droit mais générant des effets de droit dans la mesure où les usagers s’y conforment ou au contraire refusent de s’y soumettre, parfois opposables à l’institution qui les a édictés, ces mécanismes sont d’une extrême diversité, diversité que le Droit tente de saisir avec plus ou moins de bonheur.
On l’aura compris, si comme le suggère l’intitulé de cet après-midi de la protection sociale, il n’y a rien à voir du côté des circulaires, il y a en revanche beaucoup à dire de leur portée normative, de leur juridicité, de leur invocabilité devant le juge et des conséquences de leur inobservation, notamment par les organismes supposés les mettre en œuvre. Nos trois intervenants échangeront sur ces différents points et feront apparaître les axes de ce qui pourrait être le régime juridique en devenir de ces objets juridiques atypiques.Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir Kristel Meiffret Delsanto, Maîtresse de conférences à l’université de Lorraine, Martin Abry-Durand, Maître de conférences à l’université de Lorraine et Maître André Derue, avocat associé au Cabinet Barthélémy Lyon, Membre du conseil scientifique Barthélémy Avocats. Bibliographie indicative :
Kristel Meiffret Delsanto, Une suppression de la procédure d’abus de droit sujette à contentieux, Droit social, 2024, n° 3, p. 212
Kristel Meiffret Delsanto, De l’art de la (dé)mesure dans la lutte contre la fraude sociale, Droit social, 2023, n°4, p. 356
Kristel Meiffret Delsanto, Le droit à l’erreur en droit de la sécurité sociale : bilan et perspectives, in La politique de sécurisation juridique de l’URSSAF de l’intention à l’action, Bulletin Joly Travail, 2022
Kristel Meiffret Delsanto, La fraude en droit de la protection sociale, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Collection Droit social, 2018Martin Abry-Durand, Le salarié face aux URSSAF, Le droit ouvrier, n° 896, 2023, p. 191
Martin Abry-Durand, L'employeur dans le système du recouvrement social, thèse de doctorat, Université Paris-Nanterre, 2021André Derue, Une suppression de la procédure d’abus de droit sujette à contentieux, Droit social, 2024, n° 3, p. 212
André Derue, Rapport de contrôle URSSAF et principe du contradictoire, Droit social, 2024, n° 2, p. 198
André Derue, Redressement, observations pour l’avenir et contestation, Les cahiers du DRH, n° 285, 2021, p. 21 ;
André Derue, A la recherche d’un équilibre entre garanties du cotisant et prérogatives de l’URSSAF, Bulletin Joly Travail, n° 7, 2019, p. 29
André Derue, Contrôle URSSAF et procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, JCP S, 2019, n° 14, p. 33 - Quatrième session : Violences domestiques et conjugales : quelle(s) prise(s) en charge en entreprise ?
Mercredi 21 mai 2025 de 15h à 17h, en mode hybride. -
→ Lien pour (re)voir la séance sur YouTube
L’impact des violences domestiques et conjugales sur le travail est une préoccupation croissante, tant pour les employeurs que pour les acteurs externes de la prévention dont les organismes de protection sociale. En effet, ces problématiques sont accentuées dans un contexte de généralisation de travail en mode "hybride" et de recours au télétravail. Cette problématique ne peut plus être ignorée des pouvoirs publics, en particulier depuis la ratification par la France de la Convention n°190 de l’Organisation internationale du travail. Ce texte impose non seulement de garantir un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, mais aussi de reconnaître les effets de la violence domestique sur la vie professionnelle, et de prendre des mesures pour en atténuer les conséquences. La récente directive européenne 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique renforce cette exigence, en obligeant les États membres à garantir une protection effective des victimes, y compris dans leur vie professionnelle.
Dans ce contexte, nous interrogerons non seulement la prise en charge des violences conjugales et domestiques dans le cadre de l’entreprise, mais aussi les dispositifs de prévention mobilisables pour détecter, empêcher et faire cesser l’impact de ces violences dans l’environnement de travail. Cette rencontre sera également l’occasion d’examiner une question juridique centrale : dans quelle mesure les violences domestiques peuvent elles être qualifiées de risques professionnels ? Quels effets une telle qualification pourrait-elle produire sur l’assurance contre les risques professionnels ? Le regard comparé Québec-France, déjà riche d’enseignements sur l’intégration de ces violences dans l’obligation de sécurité, permettra de nourrir la réflexion sur les évolutions juridiques possibles, voire nécessaires, dans le droit social français.Nous avons le plaisir d'accueillir Anik Drouin, Coordinatrice stratégique en santé des personnes, Sous-secrétariat aux ressources humaines gouvernementales, Québec, Arnaud Lucchini, Maître de conférences, université Sorbonne Paris Nord, Sophie Selusi, Maîtresse de conférences, université de Montpellier. Bibliographie indicative :
Ait Akli, A. Drouin, A. Lucchini, E. Marant, “Violences conjugales et domestiques : quelle appréhension en santé au travail ? Regards croisés France - Québec”, Bulletin Joly Travail, déc. 2024, p. 51
Cox Rachel et M. Ederer, « Le traitement de la violence conjugale comme un enjeu de SST au Canada : une étude empirique », Communitas 2021, vol. 2, n° 1, p. 194,
J. Duchatel et M. Baldeck, « Quel rôle a l’entreprise dans la lutte contre les violences domestiques ? », RDT 2023, p. 672.
L. Lerouge, « La ratification de la convention OIT n° 190 sur la violence et le harcèlement au travail. Formalité ou opportunité pour le système français ? », Dr. soc. 2022, p. 54 ; « La reconnaissance des risques psychosociaux et des violences au travail dans la loi sur la santé et la sécurité du travail au Québec », RDT 2022, p. 262 ; « La prévention de la violence et du harcèlement au travail : nouveaux enjeux au regard de la Convention OIT n° 190 », BJT déc. 2024
K. Messing et R. Cox, « Une tonne de plumes pèse autant qu’une tonne de plomb. Vers la reconnaissance et l’élimination des dangers dans le travail des femmes au Québec », Travail, genre et sociétés 2024, n° 51, p. 101.
OIT – Bureau de Paris, étude, 2023, Permettre aux partenaires sociaux de mieux s’emparer de la violence et du harcèlement au travail : étude comparée France, Belgique, Québec, L. Lerouge et C. Teyssier.
V. Pontif, « Convention n° 190 de l’OIT sur le harcèlement et la violence au travail : quelles pistes pour le droit du travail français ? », RDT 2024, p. 398
S. Selusi, « La négociation collective d'entreprise : un outil de prévention des risques psychosociaux après la loi du 2 août 2021 ? », Bulletin Joly Travail, déc. 2024, p. 47 ; “Les interactions entre sphères privées et professionnelles au travail : quels impacts lorsque le travail s’invite au domicile du salarié en matière de risques professionnels ?”, Bulletin Joly Travail, avr. 2025, p. 60
D. Tharaud,« L’angle anti-discriminatoire de la directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique », RTD eur. 2024, p. 161
N. Weilhorski, La relation entre vie familiale et vie professionnelle : incidences des violences conjugales sur les travailleuses, les travailleurs et les organisations, thèse, 2014, Paris 1
- Première session : Travail en prison.
- Année 23/24
-
- Première session : Réflexions autour des conventions médicales.
Mardi 9 mai 2023 de 14h à 16h, en mode hybride.. -
Vivons-nous depuis le 31 mars 2023 un moment inédit dans l’histoire des conventions médicales ? Possiblement ! Après la dénonciation de la dernière convention médicale par les organisations représentatives des médecins et en l’absence pour l’instant de règlement arbitral, ne sommes-nous pas actuellement confronté·es à un vide juridique faute de fondement légal, règlementaire ou conventionnel pour fixer les bases de remboursement des frais de santé ? Cette question et bien d’autres telles que la liberté d’installation, la représentativité des organisations professionnelles ou la place des conventions médicales seront discutées lors de ce premier Après-midi de la protection sociale qui ne restera pas sans lendemain ! Rendez-vous en effet le mardi 18 juin 2024 pour un échange autour des contrats courts.
Avec les interventions de Charlène Collet (Docteure en droit, agence régionale de santé d’Occitanie), Marion Del Sol (Professeure à l'Université Rennes 1), Ylias Ferkane (Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre) et Sophie Nadal (Professeure à Cergy Paris Université). - Deuxième session : Les transitions collectives.
Jeudi 30 novembre 2023 de 14h à 16h, en mode hybride. -
→ Lien pour (re)voir la séance sur YouTube
Les transitions collectives, qui ont été initiées et conçues au cours de l’année 2020 par le ministère du Travail, s'inscrivent dans le cadre de France Relance. Elles consistent à éviter les licenciements en facilitant au sein d’un même espace territorial le passage de salariés d’une branche d’activité en déclin vers un autre secteur d’activité qui apparaît plus porteur en terme d’emplois. La mise en œuvre de ce dispositif implique d’identifier les emplois concernés en faisant appel au dialogue social dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), d’organiser la transition par le projet de transition professionnelle et enfin de le financer.
Au-delà des rouages techniques et des outils juridiques utilisés, la prise en charge des transitions collectives rouvre le débat sur l’intérêt d’instituer une sécurité sociale professionnelle, entendue, entre autres, comme un outil de mutualisation des financements des entreprises dans un espace géographique donné pour accompagner les évolutions professionnelles des salariés.Pour débattre de ce dispositif et de ses enjeux, interviendront Josépha Dirringer (maîtresse de conférences à l'Université de Rennes), Pierre-Emmanuel Berthier (maître de conférences à l'Université de Lyon 2), Stéphane Bochard (CGT Auvergne Rhône Alpes) et Pascal Caillaud (chargé de recherche au CNRS, Université de Nantes). - Troisième session : Santé au travail dans le domaine agricole.
Mercredi 31 janvier 2024 de 14h à 16h, en mode hybride. -
→ Lien pour (re)voir la séance sur YouTube
Depuis la disparition du régime social des indépendants, la Mutualité Sociale Agricole est devenue le deuxième régime de sécurité sociale par le nombre de personnes protégées. Pourtant, son fonctionnement, ses spécificités restent assez méconnus, à l’image par exemple du service de santé agricole dont l’organisation relève de la responsabilité des caisses de mutualité sociale agricole. Ce sont ces questions de santé et de sécurité au travail dans le domaine agricole que nous vous proposons d’aborder tant sous l’angle institutionnel que des actions et politiques mises en œuvre.Avec les interventions d’Alexandre Charbonneau (Maître de conférences à l’université de Bordeaux), Morane Keim-Bagot (Professeure à l’université de Strasbourg) et Hanane Mouftadi (Attachée de direction, Direction Santé Sécurité au Travail, Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole). - Quatrième session : Négocier la prévoyance dans la fonction publique.
Mardi 19 mars 2024 de 16h30 à 18h30, en mode hybride. -
→ Lien pour (re)voir la séance sur YouTube
Depuis quelques années, le paysage de la protection sociale se modifie à grande vitesse dans la fonction publique. En parallèle des réformes des retraites qui impactent fortement les agents, le chantier des couvertures complémentaires santé et prévoyance accapare les administrations publiques et les organisations syndicales. Trouvant son origine dans la remise en cause du monopole des mutuelles de fonctionnaires en 2007, ses fondations demeurent absconses pour les non-spécialistes : à la suite d’une ordonnance de février 2021 fixant un objectif de généralisation des complémentaires santé et prévoyance dans les trois fonctions publiques, un enchevêtrement de décrets d’application et d’accords collectifs déclinés au triple niveau interministériel, ministériel et local, met progressivement en place les nouveaux droits des agents publics.
Si le nouveau régime qui se constitue est influencé par la généralisation de la complémentaire santé dans le secteur privé, il n’en est pas le simple décalque. Contemporaines de la réforme de la négociation collective dans la fonction publique (également introduite par ordonnances en 2021), les complémentaires santé et prévoyance semblent bien être un terrain d’expérimentation d’une nouvelle articulation des normes en droit public du travail. Nos invité∙es discuteront du nouveau régime de la négociation et des accords collectifs dans la fonction publique, de son articulation avec le(s) statut(s) des agents publics et des modèles de protection sociale qui se dessinent. Avec en toile de fond, un questionnement : ce nouveau droit collectif agirait-il aussi comme un révélateur des évolutions du droit du travail ?Avec les interventions de Florence Debord (Professeure à l’Université Lumière Lyon 2), Nicolas Di Camillo (Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté) et Morgan Sweeney (Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine). - Cinquième session : Droits des personnes en situation de handicap : vers la désinstitutionalisation ?
Jeudi 23 mai 2024 de 14h à 16h, en mode hybride. -
→ Lien pour (re)voir la séance sur YouTube
La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi compte un titre III intitulé « Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap ». Si l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi sont des éléments essentiels dans la construction d’une société inclusive, ce ne sont pas les seuls droits qui doivent être garantis. La liberté de mener une vie amoureuse et sexuelle, qui reste largement un tabou, est insuffisamment mise en œuvre, particulièrement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le renforcement des droits et libertés fondamentales des personnes en situation de handicap soulève directement la question de l’accompagnement. Elle est aujourd’hui reposée à travers le mouvement de « désinstitutionalisation ». Dans ce nouveau cadre de pensée, il s’agit de favoriser un accompagnement, qu’il soit professionnel, économique ou social, « hors les murs » qui valorise l’expertise des professionnels dont l’intervention se fait sur les lieux de vie de la personne en situation de handicap, à son domicile ou en milieu ordinaire de travail. Pour quelle effectivité des droits civils et sociaux des personnes concernées ?Avec les interventions de Stéphanie Berthomé (Docteure en droit, Évaluatrice externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux et Directrice d'établissements et services pour enfants en situation de handicap), Laurène Joly (Maîtresse de conférences, université de Bordeaux), Guillaume Rousset (Maître de conférences, Habilité à diriger des recherches, université Jean Moulin Lyon 3, IFROSS/CRDMS). Bibliographie :
- Berthomé S., Les leviers juridiques à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap dans les entreprises, Thèse de doctorat, Rennes, 10 juill. 2023 ;
- Joly L., L'emploi des personnes handicapées entre discrimination et égalité, Dalloz, 2015, Nouvelle bibliothèque de thèses ;
- Rousset G., « Travailleurs du soin ou travailleurs du sexe ? - Réflexions juridiques sur les assistants sexuels dans le champ du handicap », in Pierron J.-P, Vinot D., Chelle E. (dir.), Travail du soin, soin du travail - Préserver la valeur intangible de la relation au sein d’organisations en tension, Seli Arslan, 2020, 192 p., p. 143.
- Première session : Réflexions autour des conventions médicales.
Informations pratiques
Lieu(x)
En distanciel (visio / live), En co-modal
Partenaires

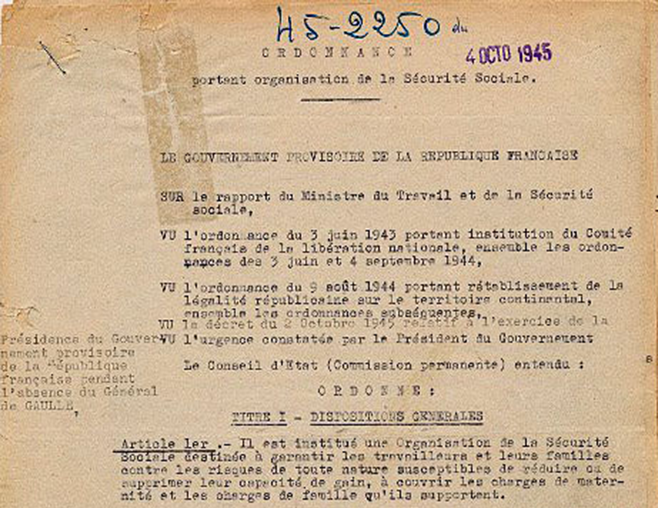
Renseignement
laure.camaji@univ-lyon2.fr
Romain Marié, Professeur des Universités
romain.marie@univ-lyon2.fr